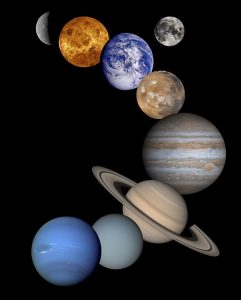Candide et Martin parviennent au palais du noble Pococurante, homme d’une soixantaine d’années, extrêmement riche. Ils découvrent avec stupéfaction que celui-ci s’ennuie de tout, de la grande musique classique, des tableaux de renommée et même des jolies femmes qui habitent son palais.
d’années, extrêmement riche. Ils découvrent avec stupéfaction que celui-ci s’ennuie de tout, de la grande musique classique, des tableaux de renommée et même des jolies femmes qui habitent son palais.
D’abord deux filles jolies servirent du chocolat, qu’elles firent très-bien mousser. […] « Ce sont d’assez bonnes créatures, dit le sénateur Pococurante ; je les fais quelquefois coucher dans mon lit : car je suis bien las des dames de la ville, de leurs coquetteries, de leurs jalousies, de leurs querelles, de leurs humeurs, de leurs petitesses, de leur orgueil, de leurs sottises, et des sonnets qu’il faut faire ou commander pour elles ; mais, après tout, ces deux filles commencent fort à m’ennuyer. »
Candide, après le déjeuner, se promenant dans une longue galerie, fut surpris de la beauté des tableaux. Il demanda de quel maître étaient les deux premiers. « Ils sont de Raphaël, dit le sénateur ; je les achetai fort cher par vanité, il y a quelques années […], mais ils ne me plaisent point du tout : la couleur en est très-rembrunie, les figures ne sont pas assez arrondies, et ne sortent point assez ; les draperies ne ressemblent en rien à une étoffe : en un mot, quoi qu’on en dise, je ne trouve point là une imitation vraie de la nature. Je n’aimerai un tableau que quand je croirai voir la nature elle-même : il n’y en a point de cette espèce. J’ai beaucoup de tableaux, mais je ne les regarde plus. »
Pococurante, en attendant le dîner, se fit donner un concerto. Candide trouva la musique délicieuse. « Ce bruit, dit Pococurante, peut amuser une demi-heure ; mais s’il dure plus longtemps, il fatigue tout le monde, quoique personne n’ose l’avouer.
[…] Candide, en voyant un Homère magnifiquement relié, loua l’illustrissime sur son bon goût. « Voilà, dit-il, un livre qui faisait les délices du grand Pangloss, le meilleur philosophe de l’Allemagne. — Il ne fait pas les miennes, dit froidement Pococurante ; […] cette répétition continuelle de combats qui se ressemblent tous, ces dieux qui agissent toujours pour ne rien faire de décisif, cette Hélène qui est le sujet de la guerre, et qui à peine est une actrice de la pièce ; cette Troie qu’on assiège, et qu’on ne prend point : tout cela me causait le plus mortel ennui. […] Tous les gens sincères m’ont avoué que le livre leur tombait des mains, mais qu’il fallait toujours l’avoir dans sa bibliothèque, comme un monument de l’antiquité. […]
— Votre excellence ne pense pas ainsi de Virgile ? dit Candide. — Je conviens, dit Pococurante, que le second, le quatrième, et le sixième livre de son Énéide, sont excellents ; mais pour son pieux Énée, et le fort Cloanthe, […] je ne crois pas qu’il y ait rien de si froid et de plus désagréable. J’aime mieux le Tasse et les contes à dormir debout de l’Arioste.
— Oserais-je vous demander, monsieur, dit Candide, si vous n’avez pas un grand plaisir à lire Horace ? — Il y a des maximes, dit Pococurante, dont un homme du monde peut faire son profit, […] mais je me soucie fort peu de son voyage à Brindes, et de sa description d’un mauvais dîner, et de la querelle de crocheteurs entre je ne sais quel Pupilus dont les paroles étaient pleines de pus, et un autre dont les paroles étaient du vinaigre. […] Les sots admirent tout dans un auteur estimé. Je ne lis que pour moi : je n’aime que ce qui est à mon usage. Candide, qui avait été élevé à ne jamais juger de rien par lui-même, était fort étonné de ce qu’il entendait ; et Martin trouvait la façon de penser de Pococurante assez raisonnable.
Contributeur: Kaptue Wilfried