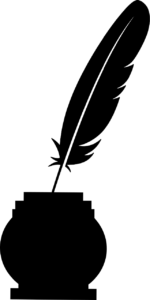Après avoir perdu son premier ministre, le roi choisit le jeune Zadig pour occuper cette place. Tous les courtisans furent contrariés, mais Zadig allait mettre son talent en usage et devenir un ministre digne et exemplaire.
Il fit sentir à tout le monde le pouvoir sacré des lois, et ne fit sentir à personne le poids de sa dignité. Il ne gêna point les voix du divan, et chaque vizir pouvait avoir un avis sans lui déplaire. Quand il jugeait une affaire, ce n’était pas lui qui jugeait, c’était la loi; mais quand elle était trop sévère, il la tempérait; et quand on manquait de lois, son équité en faisait qu’on aurait prises pour celles de Zoroastre.
C’est de lui que les nations tiennent ce grand principe, Qu’il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Il croyait que les lois étaient faites pour secourir les citoyens autant que pour les intimider. Son principal talent était de démêler la vérité, que tous les hommes cherchent à obscurcir. Dès les premiers jours de son administration il mit ce grand talent en usage. Un fameux négociant de Babylone était mort aux Indes; il avait fait ses héritiers ses deux fils par portions égales, après avoir marié leur sœur, et il laissait un présent de trente mille pièces d’or à celui de ses deux fils qui serait jugé l’aimer davantage. L’aîné lui bâtit un tombeau, le second augmenta d’une partie de son héritage la dot de sa sœur; chacun disait: C’est l’aîné qui aime le mieux son père, le cadet aime mieux sa sœur; c’est à l’aîné qu’appartiennent les trente mille pièces.
Zadig les fit venir tous deux l’un après l’autre. Il dit à l’aîné: Votre père n’est point mort, il est guéri de sa dernière maladie, il revient à Babylone. Dieu soit loué, répondit le jeune homme; mais voilà un tombeau qui m’a coûté bien cher! Zadig dit ensuite la même chose au cadet. Dieu soit loué! répondit−il, je vais rendre à mon père tout ce que j’ai; mais je voudrais qu’il laissât à ma sœur ce que je lui ai donné. Vous ne rendrez rien, dit Zadig, et vous aurez les trente mille pièces; c’est vous qui aimez le mieux votre père.
Une fille fort riche avait fait une promesse de mariage à deux mages, et, après avoir reçu quelques mois des instructions de l’un et de l’autre, elle se trouva grosse. Ils voulaient tous deux l’épouser. Je prendrai pour mon mari, dit−elle, celui des deux qui m’a mise en état de donner un citoyen à l’empire. C’est moi qui ai fait cette bonne œuvre, dit l’un. C’est moi qui ai eu cet avantage, dit l’autre. Eh bien! répondit−elle, je reconnais pour père de l’enfant celui des deux qui lui pourra donner la meilleure éducation. Elle accoucha d’un fils. Chacun des mages veut l’élever. La cause est portée devant Zadig. Il fait venir les deux mages. Qu’enseigneras−tu à ton pupille? dit−il au premier. Je lui apprendrai, dit le docteur, les huit parties d’oraison, la dialectique, l’astrologie, la démonomanie; ce que c’est que la substance et l’accident, l’abstrait et le concret, les monades et l’harmonie préétablie. Moi, dit le second, je tâcherai de le rendre juste et digne d’avoir des amis. Zadig prononça: Que tu sois son père ou non, tu épouseras sa mère.